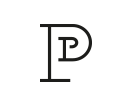Grâce au mécénat de la fondation La Marck, le Petit Palais a pu acheter en vente publique trois plaques d'argent niellées, un type d'objet non représenté dans les collections jusque-là.
Extrêmement complexes à étudier sur les plans de l’attribution et de la datation, les nielles comptent parmi les œuvres dont la compréhension et l’étude sont les plus ardues. Ce sont aussi des objets d’art qui se font aujourd’hui parmi les plus rares du marché et le Petit Palais est particulièrement reconnaissant à la fondation La Marck de lui avoir permis de faire l’acquisition de trois nielles lors d’une vente aux enchères à Munich.
Des objets d'une grande rareté
 Pratiqué par des orfèvres dès l’Antiquité, le niellage consiste à graver un motif dans une plaque d’argent à l’aide d’un burin, puis à remplir les sillons ainsi creusés à l’aide d’une mixture noire composée d’un sulfure métallique susceptible d’être obtenu à l’aide de plomb ou de cuivre. La substance noire remplit les sillons gravés dans la plaque et crée une image bichrome alliant le noir du sulfure aux surfaces scintillantes de l’argent. Ces plaques niellées pouvaient ensuite être montées sur des baisers de paix, mais aussi servir d’ornements à différents objets de la vie quotidienne.
Pratiqué par des orfèvres dès l’Antiquité, le niellage consiste à graver un motif dans une plaque d’argent à l’aide d’un burin, puis à remplir les sillons ainsi creusés à l’aide d’une mixture noire composée d’un sulfure métallique susceptible d’être obtenu à l’aide de plomb ou de cuivre. La substance noire remplit les sillons gravés dans la plaque et crée une image bichrome alliant le noir du sulfure aux surfaces scintillantes de l’argent. Ces plaques niellées pouvaient ensuite être montées sur des baisers de paix, mais aussi servir d’ornements à différents objets de la vie quotidienne.
Giogio Vasari relate en 1550 dans ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes que les nielles sont en outre à l’origine de l’une des techniques de l’estampe, celle de la gravure sur cuivre :
"Le maître florentin Maso Finiguerra a excellé dans cette technique, comme en témoignent les merveilleux « Baisers de paix » niellés de Saint-Jean à Florence. De ce travail au burin dérivent les gravures sur cuivre dont nous voyons aujourd’hui, à travers l’Italie, tant d’exemples dans notre pays ou en Allemagne. De même qu’avant de remplir de nielle les plaques d’argent, on en prenait une empreinte en terre glaise sur laquelle on jetait du soufre, de même les graveurs ont trouvé le moyen de tirer des estampes sur des planches de cuivre, à l’aide d’une presse, comme ils le font aujourd’hui".[1]
Une invention attribuée à l'artiste florentin Maso Finiguerra
 Vasari précise cette première indication dans un passage de la Vie qu’il consacre simultanément à Marc-Antonio Raimondi et d’autres graveurs :
Vasari précise cette première indication dans un passage de la Vie qu’il consacre simultanément à Marc-Antonio Raimondi et d’autres graveurs :
"C’est le Florentin Maso Finiguerra qui est à l’origine de la gravure sur cuivre aux environs de 1460. Il prenait une empreinte en terre glaise de toutes les planches d’argent qu’il ciselait pour les nieller et les recouvrait de soufre liquéfié, obtenant ainsi une nouvelle planche qu’il enduisait de noir de fumée dilué dans l’huile. Il avait ainsi une parfaite reproduction de la plaque d’argent. Après l’avoir teintée de noir, il eut l’idée d’y appliquer une feuille de papier humide et de la presser à l’aide d’un cylindre parfaitement lisse ; et la feuille ne paraissait pas seulement imprimée, mais dessinée à la plume".[2]
Un heureux complément au fonds de nielles du musée
 Le même terme de « nielle » est à la fois utilisé pour désigner les plaques d’argent niellées et les estampes qui en sont tirées. En ce sens, le Petit Palais conserve l’un des plus importants ensembles de nielles (estampes) de France, mais aucun nielle (plaque d’argent niellée) ne figurait jusqu’ici dans ses collections.
Le même terme de « nielle » est à la fois utilisé pour désigner les plaques d’argent niellées et les estampes qui en sont tirées. En ce sens, le Petit Palais conserve l’un des plus importants ensembles de nielles (estampes) de France, mais aucun nielle (plaque d’argent niellée) ne figurait jusqu’ici dans ses collections.
Le volume de son Manuel de l’amateur d’estampes qu’Eugène Dutuit consacre aux nielles et qui paraît en 1883 est considéré comme le premier ouvrage de référence consacré à ces objets et aucune publication ne l’a surpassé depuis. Il identifie 710 estampes niellées, dont un grand nombre ne sont connues qu’en un unique exemplaire. La collection que les frères Dutuit ont réunie et léguée à la ville de Paris reflète l’intérêt aigu qu’ils ont porté à cette technique. Les 24 nielles conservés au Petit Palais grâce à leur libéralité font de cette institution le troisième plus important fonds de France en la matière.
B. R. Mise en ligne le 10/09/2025
[1] Giorgio Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, édition critique sous la direction d’André Chastel, Paris, Bibliothèque Berger-Levrault, 1981, t. 1, p. 201.
[2] Ibid., t. 7, p. 62.